
APPEL À COMMUNICATION
NOUVELLE DEADLINE : 14 JUILLET 2025
DÉPENDANCE, INTERDÉPENDANCE : LE STATUT DE LA LIBERTÉ
Cette année, le colloque du SIICLHA explore une thématique au cœur des expériences cliniques, éthiques et relationnelles liées au handicap et à la maladie somatique : « Dépendance, interdépendance : le statut de la liberté. »
En psychanalyse, la dépendance renvoie à la détresse (Hilflosigkeit) décrite par Freud, qui caractérise l’état initial du sujet à sa naissance. Cette détresse primaire rend compte de l’impuissance fondamentale du nourrisson, dont la survie dépend radicalement de l’autre (souvent la figure maternelle ou parentale).
Dans la clinique du handicap et de la maladie grave, dépendance et interdépendance ne peuvent être pensées comme des opposés. Elles forment les deux pôles d’une dynamique relationnelle complexe, où l’intersubjectivité joue un rôle fondamental. Cette intersubjectivité structure les interactions entre les personnes en situation de handicap, leurs aidants, et les professionnels qui les accompagnent. Elle devient ainsi le socle d’une dynamique relationnelle fondée sur la reconnaissance mutuelle, même dans un contexte de vulnérabilité accrue.
La thématique choisie interroge une tension centrale : Qu’est-ce que la liberté dans un contexte marqué par la dépendance et l’interdépendance ? La dépendance, souvent perçue comme une contrainte, peut-elle coexister avec une forme de liberté subjective ? Et dans quelle mesure l’interdépendance redéfinit-elle les contours de l’autonomie ? Ces interrogations appellent à une réflexion dynamique : la liberté ne se présente pas comme un état figé ou absolu, mais comme un processus en perpétuelle négociation. Elle peut être revendiquée, réinterprétée, compromise, ou même perdue, au fil des interactions entre les différents acteurs concernés.
Notre colloque s’inscrit dans une perspective interdisciplinaire où les notions de dépendance, interdépendance et liberté résonnent dans des champs variés : la philosophie, la psychologie, la psychanalyse, la médecine, la sociologie et l’éthique. Ce colloque offre une opportunité précieuse de croiser ces approches disciplinaires, en mettant en lumière la richesse et la complexité des enjeux relationnels, cliniques et existentiels que pose cette dialectique.
> Pré-requis : aucun
> Objectfis :
L’action de formation entre dans la catégorie des actions de formation (adaptation, promotion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances…) dans le champ du handicap prévue par l’article L. 6313-1 du code du travail.
> Modalités et délais d’accès :
Les participants peuvent s’inscrire à titre individuel (en ligne avec règlement par CB) ou par l’intermédiaire de leur employeur, au titre de la formation professionnelle.
Toute inscription est possible jusqu’au 19 novembre 2025 – 18h00, et sur place dans la limite de l’effectif maximal.
Pour les inscriptions au titre de la formation professionnelle, un formulaire en ligne est à compléter (voir bouton colonne grisée à droite). Une convention établie avec les informations reçues vous sera adressée par retour de mail. Dès réception de sa version signée, une confirmation d’inscription vous sera transmise.
Une convocation est envoyée à tous les inscrits.
Pour tout renseignement concernant ce tarif : anep0091@gmail.com
> Méthodes mobilisées :
- Conférences plénières et tables rondes faites par des experts dans la thématique
- Cas cliniques exposés et discutés.
- Films illustrant certains points du programme.
- Ateliers avec d’échanges interactifs entre les participants et les exposants.
Le débat entre les participants est privilégié pour permettre l’appropriation des nouvelles connaissances.
Les conférenciers et les animateurs des ateliers sont particulièrement attentifs à faciliter l’articulation entre les apports théoriques et les pratiques des participants. Ils cherchent à susciter l’interrogation sur la pratique, à réfléchir sur les dispositifs de soin des personnes en situation de handicap et leurs familles.
La mise en tension entre théorie et pratique est un point essentiel.
Des supports de lecture et une bibliographie seront distribués aux participants.
> Modalités d’évaluation :
- Évaluation des acquis en fin de session par un questionnaire/auto- évaluation.
- Évaluation de la satisfaction par un questionnaire en fin de session.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
L’accès au colloque est possible aux personnes à mobilité réduite ; des hôtesses présentes sur place peuvent accompagner les personnes en situation de handicap visuel.
L’entrée est accessible aux PMR. Un parcours spécifique sera fléché.
L’accès est gratuit aux accompagnants de personnes en situation de handicap.
Selon votre situation et dans la mesure de nos possibilités, des modalités de compensation et d’adaptation sont mises en œuvre.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez nous faire part d’une situation de handicap : contact@siiclha.com
Avec le soutien

Partenaires

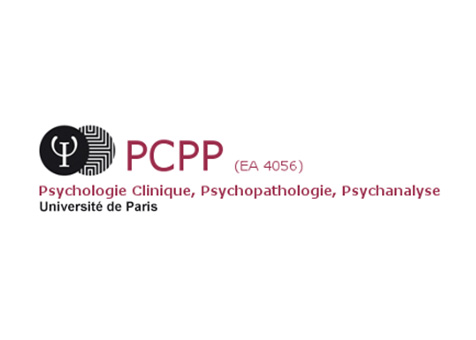
Comité d’organisation
- Pierre Ancet, Professeur, philosophe, Université de Bourgogne – Dijon
- Marco Araneda, MCF (CRPMS) Université́ Paris Diderot
- Anne Boissel, MCF- HDR (CRFDP) Université́ Rouen Normandie
- Sophie Boursange, psychologue clinicienne, Doctorante (PCPP), Université Paris-Cité
- Albert Ciccone, professeur (CRPPC) Université́ Lyon 2
- Clémence Dayan, MCF (CLIPSYD) Université Paris-Nanterre
- Caroline Demeule, docteure en psychologie clinique, psychologue, Paris
- Marcela Gargiulo, professeur (PCPP) Université́ Paris
- Johan de Groef, philosophe, psychanalyste, pédagogue, Louvain (Belgique)
- Tamara Guenoun, MCU, psychologue, Lyon
- Simone Korff-Sausse, MCF (CRPMS) Université Paris
- Sylvain Missonnier, professeur (PCPP) Université Paris
Intervenants
- Pierre Ancet, professeur de philosophie (LIR3S), Univ. de Bourgogne
- Joanne André, MC, Univ. Paris Cité
- Marco Araneda, MCF en psychologie (CRPMS), Univ. Paris-Cité
- Anne Boissel, MCF HDR en psychologie (CRFDP), Univ. Rouen Normandie
- Delphine Bonnichon, MCU , Univ. Catholique d’Angers
- Sophie Boursange, docteur en psychologie, psychologue clinicienne, (PCPP), Univ. Paris-Cité
- Sarah Bydlowski, psychiatre psychanalyste, Univ. Paris Cité)
- Albert Ciccone, professeur émérite de psychologie (CRPPC) , psychanalyste, Univ. Lyon 2
- Clémence Dayan, psychologue clinicienne Centre de référence des maladies neuromusculaires de l’hôpital Trousseau, MCF (CLIPSYD) Univ. Paris-Nanterre
- Caroline Demeule, docteure en psychologie clinique, psychologue en Services de Chirurgie Maxillo-Faciale, ORL, Ophtalmologie et Neurochirurgie Hôpital Pité-Salpêtrière et dans le champ médico-social en ESAT, Paris
- Marcela Gargiulo, professeure de psychologie (PCPP) , Univ. Paris-Cité
- Johan de Groef, philosophe, psychanalyste, pédagogue, Louvain, Belgique
- Tamara Guenoun, MCU, CRPPC Univ. Lyon 2 • Simone Korff-Sausse, anciennement MCF en psychologie, psychanalyste Univ. Paris-Cité
- Pierre Laurian, président bénévole, Fondation DUX, Trésorier, Associaton Art-Prime et de son festival L’art de Rien, Vice-président en charge de l’inclusion, Paris Free Style Roller Academy
- Sylvain Missonnier, professeur émérite de psychologie (PCPP), psychanalyste, Univ. Paris-Cité
- Danielle Moyse, philosophe, chercheuse IRIS (CNRS, EHESS)
- Élise Ricadat, psychologue clinicienne, MC (CERMES 3 – UMR 8211) Univ. Paris Cité, Co-directrice Institut La personne en médecine (ILPEM)
- Eugénie Sarda, pédiatre
- Georges Saulus, psychiatre, philosophe
- Estelle Veyron-Lacroix, PDH, Univ. Lyon 2


